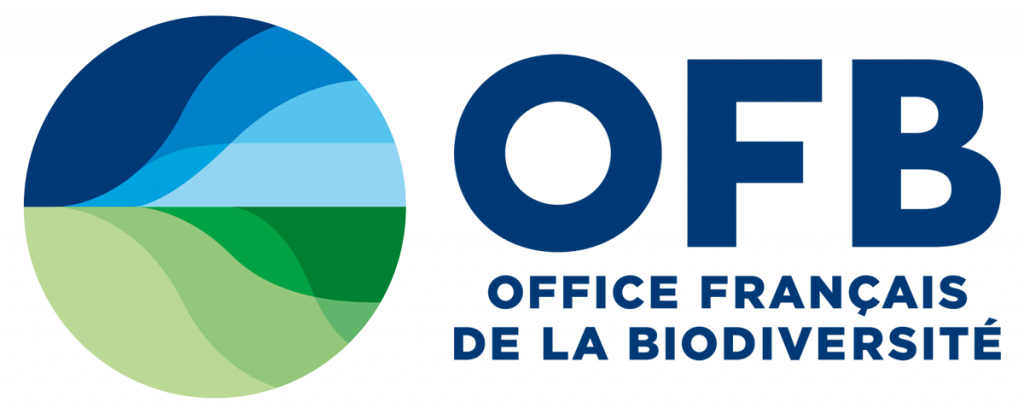Comme d’autres salmonidés dans le monde et malgré les plans de conservation de l’espèce, les populations de Saumon Atlantique (Salmo salar) se trouvent dans un état de conservation très défavorable en raison d’impacts créés par les activités humaines, comme la surpêche, la pollution des eaux et surtout la fragmentation des habitats engendrée en particulier par la présence de nombreux barrages dans les fleuves où l’espèce peut venir se reproduire. Les adultes reproducteurs de l’espèce sont des poissons de grande taille, pouvant dépasser un mètre de longueur et 20 kg, ce qui les rendaient peu vulnérables à la prédation lors de leur migration en eau douce pendant la période de frai.
Depuis l’introduction dans les eaux douces de la métropole du Poisson-chat européen, ou Silure (Silurus glanis), et l’installation de populations permanentes dans la plupart des grands cours d’eau, cette situation a changé (Guillerault et al., 2015). En effet, ce poisson de très grande taille, pouvant mesurer plus de 2,7 m de longueur et peser jusqu’à 130 kg, est un prédateur potentiel de très nombreuses espèces de poissons, y compris ceux de grandes tailles, dont le Saumon, en particulier en période de reproduction.
De plus, des adaptations de comportement de prédation de certains silures ont été observées dans certains sites, montrant une spécialisation comportementale et trophique, comme par exemple des tentatives répétées de prédation d’oiseaux posés en eaux peu profondes en bordure de cours d’eau, dont certaines couronnées de succès (Cucherousset et al., 2012). De telles observations d’adaptations comportementales ont également été faites à l’aval immédiat de barrages, équipés ou non de dispositifs de passage du poisson, où les poissons peuvent rester piégés ou au moins être fortement ralentis avant de passer le barrage, ce qui en fait des proies vulnérables à la prédation du Silure.

La Garonne était un des fleuves abritant encore le Saumon atlantique au début du 20ème siècle. Depuis les années 1980, un plan de réintroduction de l’espèce a été mis en place, ainsi que des programmes de restauration du cours d’eau dans le but de faciliter son passage malgré les obstacles, dont le barrage de la centrale électronucléaire de Golfech (Tarn et Garonne) (Thibault, 1994).
Des populations de Silure sont connues sur une grande partie du cours aval et moyen de la Garonne et la présence de silures à l’aval immédiat du barrage, voire même à l’intérieur de la passe à poissons, pouvait faire craindre que leur prédation ne vienne compromettre les efforts de conservation du saumon atlantique. Aussi Boulêtreau et ses collègues ont-ils étudié les caractéristiques de la prédation du Silure vis-à-vis du Saumon en mettant en place un dispositif d’observation spécifique temporaire et en utilisant les données rassemblées depuis 1993 sur les passages de poissons dans l’ascenseur à poisson.
Site d’étude, protocole et données utilisées
Le complexe de Golfech a été construit en 1971 sur la Garonne à environ 270 km de l’embouchure du fleuve (Croze et al., 2008) et a été équipé en 1987 d’un ascenseur à poisson sur la rive droite du canal de fuite. Le retours des saumons adultes est surveillé et les individus comptés par vidéo depuis 1993 (Travade et al., 1996). Les poissons sont attirés dans un bassin de rétention de 9 m de long, 2,5 m de large et 1,5 à 4,5 m de profondeur (Figure 1). À intervalles réguliers, en fonction de la fréquence des passages, les poissons sont piégés et concentrés dans un réservoir de 3,3 m3. Une fois surélevé, ce réservoir mobile est vidé en amont dans un canal de transfert de 250 m de long, 2 m de large et 2,5 m de profondeur qui rejoint le canal de dérivation et le cours d’eau.

Le poste de comptage vidéo permanent de la passe à poissons permet d’enregistrer le nombre et le moment des passages (Travade et al., 1996). Migado, l’association chargée d’analyser ces enregistrements, a fourni aux chercheurs le nombre quotidien de passages nets de Silure et de Saumon atlantique (c’est-à-dire, pour chaque espèce le nombre de déplacements vers l’amont moins le nombre de déplacements vers l’aval) entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2016. Les nombres de déplacements vers l’amont, vers l’aval et de passages nets des deux espèces pour chaque heure de 2004 à 2016 ont également été utilisés.
Par ailleurs, une caméra acoustique a été installée du 4 avril au 26 mai 2016 à la sortie amont du canal de transfert afin de pouvoir examiner le comportement des deux espèces dans cette zone aux eaux profondes et turbides. Elle a été positionnée de manière à ce que son champ de détection couvre toute la sortie du canal pour ne manquer aucun poisson. Les caractéristiques morphologiques spécifiques du Saumon atlantique et du Silure (taille et forme du corps, forme de la tête du Silure et nageoire dorsale du Saumon) permettent de différencier facilement et sans aucun doute ces deux espèces. Le nombre de saumons ainsi compté à la sortie de la passe a été comparé à celui relevé par vidéo dans la passe au cours de la même période afin d’estimer la prédation du Silure sur le Saumon à l’intérieur même de la passe à poisson.

Des silures ont été capturés, marqués et relâchés pour évaluer leur prédation sur le Saumon. 35 individus au total ont été capturés dans le canal de transfert, 10 en avril 2015 et 25 en avril 2016. Après une courte anesthésie permettant leur mesure et leur étiquetage par Migado à l’aide de PIT-Tag (marque semi active appelée aussi transpondeur) ces individus ont été libérés juste à l’extérieur de la sortie en amont du canal de transfert. Trois antennes de détection des PIT-Tags ont été fixées à l’intérieur du canal de transfert pour enregistrer leurs périodes de présence dans la passe à poissons.
Sur la période 1993-2016, le nombre annuel moyen de passages nets détectés de saumons atlantiques adultes est de 166. Très variable, d’un minimum de 45 individus en 2005 à un maximum de 599 individus en 2001, ce nombre a présenté un léger pic entre 1999 et 2002 (Figure 2a).
Les premiers passages nets de silures ont eu lieu en 1995, avec trois individus. Ce nombre a progressivement augmenté jusqu’en 2004 pour atteindre dans les années suivantes une moyenne annuelle de 590 individus. Les nombres annuels les plus élevés ont été comptés en 2007 et 2012, avec respectivement 1134 et 956 individus (Figure 2a).
Sur la période d’enregistrement des informations, 78 % des détections de saumons ont eu lieu entre mars et juillet et, entre 1995 et 2016, près de 95 % de celles de silures ont été faites entre avril et juillet, dont de fortes proportions en mai et juin (Figure 2b).

Les déplacements détectés vers l’aval de saumons atlantiques ont été exceptionnels jusqu’en 2014, s’accroissant fortement en 2015 puis en 2016 (Figure 3a). De 2004 à 2008, le nombre des déplacements vers l’aval du Silure est resté faible. À partir de 2009, il a très fortement augmenté, montrant, en particulier en 2015 et en 2016, des proportions très importantes de déplacements vers l’aval. Ces données suggèrent que ces silures ont passé de plus en plus de temps à l’intérieur de la passe à poissons, allant et venant devant le poste de comptage vidéo (Figure 3b).
Les détections de saumons ont été enregistrées en quasi-totalité durant la journée, entre 8h et 18h, avec une valeur médiane proche de 13h (Figure 4a). En revanche, de 2004 à 2013 (hormis en 2005), les horaires de détection des silures étaient plutôt nocturnes avec une médiane proche de 4h. Les horaires de 2014, 2015 et 2016 ont été très différents de la période antérieure puisque les détections se sont étendues de 3 ou 4h du matin à 19 ou 20h avec des valeurs médianes très différentes (Figure 4b).

Réalisés à l’aide des antennes de détection installées dans le canal de transfert, les suivis des silures marqués ont eu lieu du 20 avril au 14 juillet 2015 et du 29 avril au 16 août 2016. Sur les 35 poissons marqués, 30 (86%) ont été détectés au moins une fois par l’une des antennes. Parmi les poissons détectés, 7 (20%) ont effectué à l’occasion de l’une ou l’autre de ces deux périodes de suivi plus d’une incursion dans le canal. Le nombre d’incursions qu’ils ont effectuées et la durée cumulée de ces incursions diffèrent fortement d’un individu à l’autre. Par exemple, le nombre d’incursions de ces 7 individus varie de 2 à 21, le nombre de détections pour un individu donné par au moins une des antennes allant de 179 jusqu’à 2012. La durée cumulée par individu de ces incursions est également très variable, de 10 heures à 10 jours. Ces incursions ont été détectées principalement en début de nuit, de 21h à 23h.
Evaluation de la prédation du Silure sur le Saumon
La station de comptage vidéo du poisson permet d’observer le comportement des poissons. En l’absence de silures dans la passe, la nage des saumons en migration se déroule directement vers l’amont sans aléa. En présence de silures, en revanche, ce comportement est perturbé, de nombreux saumons faisant des va-et-vient, nageant à la surface, restant plus ou moins longtemps à l’intérieur de la passe avant de sortir, et y étant parfois attaqués.
Les enregistrements de la caméra acoustique installée du 4 avril au 26 mai 2016 à la sortie de la passe à poissons ont montré qu’il y avait souvent entre 1 et 6 silures en attente à la sortie du canal de transfert. Durant cette période, 187 individus au total de ont été observés en sortie du canal et 86 ont pénétré dans la passe à poissons.
Sur les 39 saumons dénombrés au poste de comptage vidéo durant cette même période, seuls 25 ont été observés ensuite à la sortie de la passe par la caméra acoustique. Les 14 saumons autres ont été attaqués et consommés par des silures dans le canal de transfert. Parmi les 25 saumons qui ont réussi à sortir, les temps passés dans le canal étaient très variables : 12 ont passé moins de 30 minutes, 7 entre 30 minutes et 1 heure, 5 entre 1 heure et 6 heures et 1 y a passé près de 14 heures. 18 de ces saumons ont été attaqués par un silure lors de leur sortie, mais aucun de ces actes de prédation n’a été couronné de succès.
Discussion
Les populations de ces deux espèces de poissons présentent des évolutions tout à fait opposées à l’échelle de la Garonne : saumons en déclin ou subsistant en très faibles populations, silures en développement permanent, avec même des observations sur une proportion croissance d’individus de très grandes tailles. Il est intéressant de noter que ce n’est pas le cas dans l’aire de répartition d’origine du Silure : les populations y ont diminué, de même que la taille moyenne des individus, au point que la République Tchèque a mis en place un plan de restauration des populations.
La période de migration vers l’amont du Saumon atlantique, principalement d’avril à juillet, coïncide avec la période de passage du Silure au barrage. Chez le Silure, comme beaucoup d’autres poissons d’eau douce, des migrations d’individus vers l’amont peuvent être observés avant la période de frai (Ovidio et Philippart, 2008). Ce comportement est lié à la hausse de la température de l’eau (Slavik et al., 2007) et / ou à une plus grande disponibilité de proies (Orlova et Popova, 1987).
Les saumons font bien partie des proies du Silure : de l’ADN de Saumon atlantique avait déjà été détecté dans les matières fécales de Silure dans la Garonne par Guillerault et al. (2007) mais sans précision sur l’état de santé des saumons consommés (durant la reproduction, les saumons sont très affaiblis et nombre d’entre eux meurent sans pouvoir repartir en mer).
Les présentes observations concernent des saumons encore en bonne santé et elles permettent une évaluation de la prédation : dans les conditions de l’expérimentation, environ un tiers des saumons observés dans la passe à poissons a été consommé par des silures. Il s’agit d’une prédation élevée bien que les périodes d’activité des deux espèces soient assez différentes (plutôt diurne pour le Saumon atlantique et plutôt nocturne pour le Silure), ce qui devrait en limiter le risque. Toutefois des études antérieures ont démontré que le silure n’était pas strictement nocturne et que l’activité quotidienne des individus pouvait fortement varier (Slavik et al., 2007 ; Slavik et Horky, 2012).
En ce qui concerne les plages horaires de détection des silures depuis 2004, les différences importantes entre la période 2004-2013 et les années 2014, 2015 et 2016 semblent montrer une évidente modification de comportement des silures, avec une présence diurne importante (Figure 4b), ce qui est conforté par les très fortes proportions de déplacements vers l’aval observées ces trois dernières années (Figure 3b). Par ailleurs, les suivis des silures marqués ont montré que la prédation était due aux individus restant à la sortie du canal de transfert ou se déplaçant par des va-et-vient dans la passe à poissons. Ces adaptations comportementales, comme celles déjà connues concernant les oiseaux (Cucherousset et al., 2012), ou des agrégations pouvant rassembler plus de quarante individus (Boulêtreau et al., 2011), font clairement partie du succès invasif de l’espèce.
Dans le cas présent, l’aménagement réalisé pour permettre le passage des poissons vers l’amont facilite la prédation du saumon en migration, mais pas seulement. En effet, la passe à poissons est un site permettant aux silures présents de manière continue de trouver aisément des proies, dont d’autres espèces de poissons. Les observations réalisées à l’aide de la caméra acoustique ont montré que la vitesse de nage important des saumons en sortie du canal de transfert leur avaient permis d’échapper à la prédation. Des investigations ultérieures pourraient être réalisées pour préciser les caractéristiques des comportements de prédation des silures dans ce type de contexte.
Un commentaire final

Les aménagements humains tels que les barrages sur les cours d’eau font partie des éléments constitutifs du changement global dont nous commençons à mieux évaluer les impacts sur les espèces et les écosystèmes (voir par exemple Chapin et al., 2000) et à percevoir les évolutions de ces impacts lorsque se produisent des modifications fonctionnelles des écosystèmes. En l’occurrence, les résultats des présents travaux montrent que l’arrivée d’un nouveau prédateur dans la Garonne y occasionne des dommages supplémentaires sur la population de Saumons atlantique, déjà en danger. C’est ainsi que les passes à poissons édifiées pour tenter d’atténuer l’impact des barrages sur les migrations des poissons peuvent également constituer des sites pouvant faciliter leur prédation (Agostinho et al., 2012)
Par ailleurs, il est très probable que, n’ayant aucun autre prédateur en Europe que les hommes, les populations du Silure continuent à se développer dans les milieux déjà colonisés. Si, apparemment, ces populations ne présentent pas d’impacts significatifs sur les poissons d’eau douce examinés en général (Guillerault et al., 2007), en revanche, les observations sur les adaptations comportementales de l’espèce lui permettant de développer une prédation spécifique particulièrement efficace sur des espèces amphihalines déjà en situation critique, constituent une évidente préoccupation quant au futur de la conservation de ces espèces.
Le cas du Silure illustre bien la nécessité d’envisager la problématique des EEE dans un contexte très large, embrassant aussi bien les problématiques de conservation, et les enjeux économiques et sociaux. L’expansion du Silure en France a été favorisée par l’aquaculture, puis, à la suite de l’échec de cette dernière, par la pêche de loisirs pour laquelle il représente aujourd’hui un enjeu économique considérable. Parallèlement, l’état de conservation des migrateurs amphihalins s’est dégradé sous les pressions conjuguées des obstacles à la migration, de la surpêche et de la pollution. Malgré des plans de gestion successifs, la situation ne s’est pas améliorée, montrant ainsi l’insuffisance des actions et des moyens mis en œuvre. Le Silure est venu ajouter une pression supplémentaire sur ces populations déjà mal en point. Les images de prédations (chasses, contenus stomacaux) sont venues illustrer ce phénomène, faisant du Silure le sujet de préoccupation majeur dans de nombreuses instances de conservation des migrateurs amphihalins, au point d’en éclipser les pressions historiques qui ont été à la genèse du déclin de ces populations. L’article présenté ici illustre bien les interactions entre ces pressions et les EEE : si leur hiérarchisation est nécessaire pour évaluer les moyens à mettre en place, les traiter séparément n’a pas de sens et ne pourra aboutir à la restauration des populations d’amphihalins. Cela souligne, s’il le fallait encore, que l’introduction ou la dispersion d’une espèce exotique, même sous des motifs économiques ou écologiques, doivent être évitées : notre capacité à envisager les interactions présentes et plus encore à venir étant particulièrement faibles.
Rédaction : Alain Dutartre, expert indépendant.
Relectures : Emmanuelle Sarat et Doriane Blottiere, Comité français de l’UICN, Nicolas Poulet, AFB.
Pour en savoir plus :
- Boulêtreau S., Gaillagot A., Carry L., Tétard S., De Oliveira E., Santoul F. 2018. Adult Atlantic salmon have a new freshwater predator. PLoS ONE 13(4), 12 p.
- Une vidéo signalée dans l’article
- Une vidéo du poste de comptage de Golfech
- Une vidéo sur le Silure en Dordogne
- Des vidéos montrant les comportements de prédation du Silure vis-à-vis d’oiseaux en bordure des eaux : Lien 1, Lien 2
Références bibliographiques :
- Agostinho AA, Agostinho CS, Pelicice FM, Marques EE. 2012. Fish ladders: safe fish passage or hotspot for migration. Neotrop Ichtyol. 10: 687-696.
- Boulêtreau S, Cucherousset J, Villéger S, Masson R, Santoul F. 2011. Colossal aggregations of giant alienfreshwater fish as a potential biogeochemical hotspot. PLoS ONE. 6: e25732.
- Chapin FS, Zavaleta ES, Eviner VT, Naylor RL, Vitousek PM, Reynolds HL, et al. 2000. Consequences of changing biodiversity. Nature.; 405: 234-242.
- Croze O, Bau F, Delmouly L. 2008. Efficiency of a fish lift for returning Atlantic salmon at a large scale hydroelectric complex in France. Fisheries Manag Ecol. 15: 467±476.
- Cucherousset J, Boulêtreau S, Azémar F, Compin A, Guillaume M. 2012. “Freshwater Killer Whales”: beaching behaviour of an alien fish to hunt land birds. PLoS ONE. 7: e50840.
- Guillerault N, Delmotte S, Boulêtreau S, Lauzeral C, Poulet N, Santoul F. 2015. Does the non-native European catfish Silurus glanis threaten French river fish populations? Freshwater Biol. 60:
922-928 - Orlova EL, Popova OA. 1987. Age related changes in feeding of catfish, Silurus glanis, and pike, Esox lucius, in the outer delta of the Volga. J Ichthyol. 27: 54-63
- Ovidio M, Philippart JC. 2008. Movement patterns and spawning activity of individual nase Chondrostoma nasus (L.) in flow-regulated and weir-fragmented rivers. J Appl Ichthyol. 24:
256-262. - Slavik O, Horky P. 2012. Diel dualism in the energy consumption of the European catfish Silurus glanis. J Fish Biol. 81: 2223-2234.
- Slavik O, Horky P, Bartos L, Kolařova J, Randak T. 2007. Diurnal and seasonal behaviour of adult and juvenile European catfish as determined by radio-telemetry in the River Berounka, Czech Republic. J Fish Biol. 71: 104-114.
- Thibault M. 1994. Aperçu historique sur l’évolution des captures et des stocks. In: Gueguen JC, Prouzet P, Editors. Le saumon atlantique. IFREMER: Plouzané. 175-184
- Travade F, Larinier M, Boyer-Bernard S, Dartiguelongue J. 1996. Feedback on four fishpass installations recently built on two rivers in Southwest France. ICES J Mar Sc. 14: 1-17