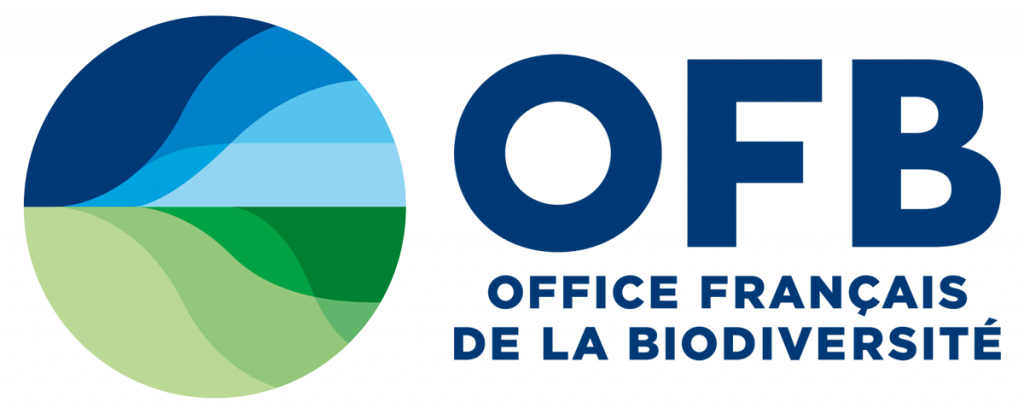Dans un article début 2020 dans la revue Conservation Biology, Mark Sagoff, professeur en philosophie à l’Université George Mason en Virginie (USA), devait se douter que sa publication intitulée Fact and value in invasion biology, pouvant être traduit comme “Faits et valeurs en biologie des invasions”, allait susciter des réactions de certains chercheurs.
Ce n’était pas la première fois qu’il allait se trouver dans une controverse sur les invasions biologiques, leurs enjeux et leurs représentations. Les titres de deux de ses publications datant d’une vingtaine d’années étaient déjà tout à fait explicites sur son approche : What’s wrong with invasive species? (1999), traduit par “Quel est le problème avec les espèces envahissantes ?” (quoique wrong puisse aussi être traduit par “erroné”, “faux”) et Why exotic species are not as bad as we fear (2000), “Pourquoi les espèces exotiques ne sont pas aussi mauvaises que nous le craignons”.
En 2017 et 2018, il a également été un des protagonistes d’un échange de publications, que nous ne commenterons pas ici, opposant ses prises de positions à celles de plusieurs chercheurs engagés sur les invasions biologiques.
Sa publication de début 2020 a donc obtenu une réponse publiée dans la même revue (Cuthbert et al., 2020) au nom de 19 co-auteurs appartenant à autant de laboratoires ou équipes d’une douzaine de pays, dont la France. Son titre est explicite : Invasion costs, impacts, and human agency: Response to Sagoff 2020, “Coûts d’invasion, impacts et action humaine : réponse à Sagoff 2020”. Les versions originales et les traductions des déclarations d’impacts (Article impact statement) des deux articles montrent bien l’objet de la controverse.
« Contested invasion-biology issues are clarified so opposition groups can together achieve shared goals with evidence based solutions. » (Sagoff, 2020)
Trad. : Les questions contestées de biologie d’invasion sont clarifiées afin que les groupes d’opposition puissent ensemble atteindre des objectifs communs avec des solutions fondées sur des preuves.« In an era of profound biodiversity crisis, invasion costs, invader impacts, and human agency should not be dismissed. » (Cuthbert et al., 2020)
Trad. : À une époque de crise profonde de la biodiversité, les coûts d’invasion, les impacts des envahisseurs et l’action humaine ne doivent pas être écartés.
Sagoff indique que sa publication porte sur les analyses de quatre domaines des connaissances en biologie des invasions.
- Le premier concerne les évaluations de coûts de gestion des EEE, plus particulièrement les estimations de Pimentel et al. (2000 et 2005) et les utilisations qui en ont été faites depuis.
- Le deuxième est le classement des impacts des EEE sur la biodiversité comme deuxième cause d’extinctions, incluant toutes les espèces y compris les plantes.
- Le troisième domaine examiné rassemble des avis sur les différences de caractéristiques et de fonctionnements entre les communautés indigènes et les envahies, et les écosystèmes envahis ou non.
- Le dernier domaine, enfin, porte sur un “fossé ontologique”, c’est-à-dire sur la différence de nature existant entre les invasions biologiques d’origine humaine et les déplacements naturels d’espèces que défendent ceux qu’il définit comme “biologistes des invasions”.
L’introduction de son article se termine par une explication de sa méthode d’examen qui a consisté à évaluer si, comme selon lui le croient ces biologistes de l’invasion, les objections dans ces domaines issues “des contrariants et des négationnistes” (contrarians and denialists) qu’il représente ne seraient pas expliquées par des “motivations ingénues, perverses, vénales et idéologiques” (considered these 4 kinds of denialist objections and whether, as prominent invasion biologists believe, ingenuous, perverse, venal, and ideological motivations account for them).
La réponse de Ross N. Cuthbert et ses collègues débute par un rappel sur le fait que les développements des sciences de l’invasion dans cette période de fortes pertes de biodiversité se sont accompagnés d’une augmentation du déni qui exploite l’incertitude, ignore ou déforme les preuves empiriques, allègue des biais et jette un doute sur le consensus (an increase in denialism that exploits uncertainty, ignores or misrepresents empirical evidence, alleges bias, and casts doubt on consensus). Elle présente ensuite les éléments contredisants les commentaires et conclusions de Mark Sagoff sur les quatre domaines de connaissance qu’il a analysé.
Évaluation des coûts de gestion des EEE
Ayant passé en revue diverses publications citant comme références les évaluations des coûts économiques réalisées par Pimentel et al. (2000 et 2005), à la suite d’une recherche sur internet montrant le nombre très important de ces citations (environ 4000 pour les deux articles), Sagoff note que les chiffres cités varient selon les citations et les commentaires et que, selon lui, les articles de Pimentel et al. “sont beaucoup plus souvent cités que lus” (far more often cited than read).
Il commente assez longuement les modes de calculs de différents éléments de ces évaluations en en montrant les limites et se réfère à quelques publications les critiquant pour en conclure que les montants financiers cités sont largement surestimés. Un chapitre de son article est par ailleurs consacré à l’exemple de la moule zébrée (Dreissena polymorpha) dont les coûts économiques de la gestion avaient fait partie des travaux de Pimentel et al., en citant diverses publications remettant également en cause les chiffres y figurant.

Il indique aussi que ces évaluations économiques portent sur les coûts de gestion des EEE, ce qui n’inclut pas les coûts de dommages, en ajoutant que l’on peut soupçonner que les demandes d’augmentations des budgets de gestion de ces espèces par des organismes auprès des financeurs pourraient profiter à ces organismes et non au public (If a government agency identifies a threat to persuade Congress to increase its budget to fight, it one may suspect that it is the agency not the public that benefits). Il cite ainsi à titre d’exemple le service des forêts des USA pour la prévention des feux.
La lecture de cette partie de son article fait nécessairement poser une question concernant le fait que son analyse critique se réfère à seulement deux publications dont la plus récente a déjà 15 ans.
C’est précisément sur ce point que la réponse de Cuthbert et ses collègues insiste en rappelant que si les chiffres de Pimentel ont été régulièrement cités en raison d’un manque antérieur d’estimations des coûts d’invasion, ils ne font pas pour autant consensus. Depuis leurs publications, divers autres travaux ont été réalisés, dont ceux de Holmes et al. (2009) ou de Perrings (2011), d’autres prenant en compte les coûts liés aux dommages (Bradshaw et al., 2016 ; Paini et al., 2017 ; van Wilgen et Wilson, 2018). Ceux de Bradshaw et al. (2016) suggéraient même que les calculs de Pimentel étaient massivement sous-estimés.
Les travaux en cours dans le programme InvaCost, s’appuyant sur une recherche standardisée d’informations issues d’articles et de littérature grise, évaluées par des pairs (Diagne et al., 2020), devraient produire des chiffres susceptibles de remplacer ceux de Pimentel.
Impact et rôle des EEE dans les extinctions d’espèces

L’article de Sagoff remet en question le classement des EEE comme deuxième cause d’extinction d’espèces après le changement d’habitat car les espèces non prédatrices, telles que les plantes, sont incluses dans cette analyse alors qu’elles n’ont pas été la cause directe ou principale de l’extinction d’espèces indigènes. Il admet que des prédateurs envahissants provoquent des extinctions, en citant le Serpent arboricole brun (Boiga irregularis) à Guam, un exemple incontesté de prédation et d’extinctions d’espèces d’oiseaux, de chauves-souris et de reptiles indigènes, mais, selon lui une différence devrait être faite entre prédation et compétition. La concurrence exercée par les EEE non prédatrices ne serait donc pas une cause importante d’extinction et il se réfère à la publication de Blackburn et al. (2019) pour l’appuyer.
Il est à noter ici que la grille d’analyse utilisée ici par Sagoff pour présenter le sujet comporte un seul critère, les extinctions d’espèces causées par les EEE. Il s’agit d’un cas très particulier des impacts causés par les EEE, alors que depuis plusieurs décennies des données ont été acquises sur les modifications des communautés et des écosystèmes induites par les EEE, dont les plantes, ces modifications pouvant tout à fait contribuer à des régressions plus ou moins importantes de la biodiversité.
Cuthbert et ses collègues contestent la manière dont Sagoff a commenté les résultats présentés par Blackburn et al. (2019) (qui fait partie des co-auteurs de la réponse de Cuthbert) : dans leur article, ces auteurs estimaient que les espèces non indigènes étaient la seule cause ou contribuaient respectivement à 25 % et 33 % des extinctions végétales et animales, ceci sans commentaire sur le rôle des plantes exotiques dans ces extinctions. Ils réagissent également sur cette analyse posée sur une base très réduite (l’extinction comme résultat extrême des impacts) en rappelant que les plantes exotiques envahissantes peuvent également créer des dommages à la biodiversité, dont des altérations des habitats, et contribuer ainsi aux risques d’extinctions (Pyšek et al., 2012 ; Baider & Florens, 2011 ; Downey & Richardson 2016). Cette partie de leur texte est même intitulée « Damage by Non predatory Species » (“dommages causés par les espèces non prédatrices”) pour sortir le débat de ces seules extinctions. Les invasions biologiques peuvent réduire la biodiversité selon différents processus, tels que la concurrence ou la compétition, l’hybridation, les modifications de structure et de fonctionnement des écosystèmes et la transmission de maladies, tous types d’impacts directs ou indirects déjà bien documentés dans la littérature scientifique.
Différences biologiques entre les espèces envahissantes et indigènes
Sagoff prétend qu’un “troisième pilier du consensus” (a third pillar of the consensus) en biologie des invasions repose sur l’hypothèse que des différences biologiques caractéristiques distinguent les espèces indigènes des EEE et les écosystèmes indemnes de colonisation de ceux colonisés. Les invasions biologiques perturberaient la structure et le fonctionnement des écosystèmes et les écosystèmes envahis seraient donc “dégradés”. Selon lui, il devrait alors être possible pour un observateur de discriminer les écosystèmes envahis des autres en examinant ou en testant ceux qui sont et ne sont pas dégradés. Il ajoute qu’un tel observateur devrait être capable de définir à partir des organismes vivants dans un l’habitat (le biote ou biota), les états de cet écosystème avant et après l’invasion.
A propos des espèces, il se questionne sur les différences biologiques “objectives” entre natives et exotiques (objective biological difference between native and non-native) et sur les connaissances historiques qui seraient nécessaires pour différencier ces espèces, y compris en incluant les influences humaines sur leur répartition et leur histoire de vie. Il indique également que, selon lui, les biologistes de l’invasion n’ont pas réussi à identifier un trait biologique général pour les espèces introduites et remet en question les hypothèses de coévolution des communautés sur lesquelles s’appuient nombre de travaux de recherche portant sur le fonctionnement des écosystèmes.
Dans cette partie de l’article, Sagoff semble confondre les traits biologiques attribuables aux espèces, pouvant éventuellement identifier ceux qui permettent à certaines espèces de devenir envahissantes dans les milieux d’accueil, et les modifications de fonctionnement des écosystèmes attribuables à la présence d’EEE. Et il met la barre assez haut, en citant comme objectif l’identification d’un seul trait biologique explicatif des capacités d’invasion…
Dans leur réponse, Cuthbert et ses collègues indiquent que les recherches sur les traits biologiques ont déjà permis d’établir des profils de futures espèces envahissantes dans divers groupes taxonomiques (van Kleunen et al., 2010 ; Dick et al., 2017 ; Cuthbert et al., 2019 ; Fournier et al., 2019). Sur la question de la coévolution des communautés, ils contestent également l’approche de Sagoff qui semble confondre les modifications intraspécifiques d’évolution avec les pressions évolutives au sein des communautés.
Le manque d’informations historiques peut en effet ne pas permettre la discrimination des écosystèmes envahis et non envahis, mais il s’agit d’une difficulté rencontrée dans de nombreux domaines scientifiques, que les sciences de l’invasion ont aussi à affronter comme un défi.
Le fonctionnement des communautés envahies peut être modifié de manière plus ou moins perceptible et ils terminent cet élément de réponse par la phrase suivante :
« By suggesting that every invasion should be easily identifiable, Sagoff undermines the level of scientific expertise that underpins ecology » (Cuthbert et al., 2020)
Trad. : En suggérant que chaque invasion devrait être facilement identifiable, Sagoff sape le niveau d’expertise scientifique qui sous-tend l’écologie.
Dualisme homme-nature

Sagoff défend le fait que les définitions portées par les biologistes de l’invasion sur les populations introduites et envahissantes donneraient aux humains un pouvoir sur les espèces non-humaines en pouvant les rendre “étrangères”, séparant ainsi les humains de la nature. Il rappelle des réflexions datant de la première moitié du 20ième siècle sur l’appartenance des sociétés humaines à la nature selon les différents niveaux de culture (“various culture levels“, il ne cite pas la technologie).
Ce dualisme attribué à la biologie de l’invasion aurait pour conséquence que le concept d’invasion ne différerait pas de ceux de colonisation ou de dispersion et, pour lui, il n’est pas possible de tester empiriquement qu’une espèce introduite est étrangère ou qu’un système envahi n’est pas naturel. Il conclut cette partie de son article par une constatation : ce dualisme entre l’humanité et la nature ne peut être trouvé dans aucune autre science biologique que l’écologie.
« Only the ecological greet human–nature dualism with a straight face » (Sagoff, 2020)
Trad. : Seuls les écologistes saluent le dualisme homme-nature avec un visage impassible
Donner un statut à une espèce selon des critères établis et utiliser ensuite ce statut comme base de référence pour des actions n’a rien à voir un quelconque dualisme. Le fait que les impacts des activités humaines s’exercent sur l’ensemble des communautés non-humaines de la planète n’en exclut pas pour autant notre espèce de la nature.
Cuthbert et ses collègues répondent que la définition des espèces envahissantes par les scientifiques de l’invasion ne signifie pas qu’ils croient que les humains ne sont pas le produit de l’évolution et qu’ils ne sont pas concernés par les lois de la génétique ou d’autres sciences biologiques. Ils défendent le fait que les activités humaines étant un facteur clé dans les invasions de certaines espèces, les humains devraient être responsables de leurs actions et de leurs conséquences, ces impacts, en essayant de les arrêter ou de les réduire.
Ils rappellent également que chercher à abolir la distinction entre nature et culture est une tentative classique de déresponsabilisation : si tout devait être considéré comme naturel, y compris les impacts des activités humaines, aucun des dommages causés par les humains ne justifieraient réparation ou arrêt. La négation de cette distinction annulerait également les valeurs associées à la préservation de la biodiversité et la justification des interventions de gestion des EEE.
Les conclusions des deux articles
Intitulée “Déni” (Denialism), la dernière partie de l’article de Sagoff (2020) revient sur les controverses subsistantes entre ce qu’il défend et les thèses des “biologistes de l’invasion”. Il passe en revue divers commentaires ou accusations, qu’il signale comme erronés, présentes dans des publications récentes de ses opposants à propos de ses propres thèses. Enfin, avec une ironie explicite, il saluerait les preuves de plusieurs des idées défendues par ses opposants tout en terminant par le fait que selon lui ces preuves n’existent pas.
« I welcome evidence that the zebra mussel imposes costs of $1 billion a year in the United States, that introduced plants are major extinction threats, that there are characteristic biological differences between heirloom and novel ecosystems, and that humanity is ontologically separate from nature. I do not think this evidence will be forthcoming. » (Sagoff, 2020)
Trad. : Je salue les preuves que la moule zébrée impose des coûts d’un milliard de dollars par an aux États-Unis, que les plantes introduites sont des menaces d’extinction majeures, qu’il existe des différences biologiques caractéristiques entre les écosystèmes traditionnels et les nouveaux écosystèmes, et que l’humanité est ontologiquement séparée de la nature. Je ne pense pas que ces preuves seront apportées.
Dans leur conclusion, Cuthbert et ses collègues notent que les critiques de Sagoff dans les quatre thématiques qu’il a choisi de présenter sont “mal informées” (misinformed) et que les thématiques critiquées sont étayées par des preuves et s’appuient sur un consensus d’experts. Ils renvoient à Sagoff ses accusations d'”autocitations” des publications de ses opposants.
« In contrast to informed sceptics who advance science, denialists mislead scientists, stakeholders, and policy makers by repeating debunked claims » (Cuthbert et al., 2020)
Trad. : Contrairement aux sceptiques avertis qui font avancer la science, les négationnistes induisent en erreur les scientifiques, les parties prenantes et les décideurs en répétant des affirmations déjà démenties.
La dernière phrase de leur publication est un appel aux éditeurs de revues à “reconsidérer l’acceptation des essais négationnistes, malgré les augmentations potentielles du facteur d’impact” (to reconsider acceptance of denialist essays, despite potential boosts to impact factor).
Que tirer de cette confrontation ?
Les controverses scientifiques sont normales et nécessaires : elles participent de l’évolution des sciences. Débats, remises en cause, “guerres de chapelles”, confrontations de résultats et d’analyses, etc., font partie de la construction de connaissances scientifiques qui finissent par être validées, admises dans un consensus par l’ensemble de la communauté des chercheurs. Il est des disciplines, s’appuyant sur des processus physiques ou chimiques ou des données mathématiques, où cette validation est relativement aisée à atteindre.
Une telle validation par consensus n’est sans aucun doute pas si facile à obtenir pour ce qui concerne l’écologie, en particulier l’écologie des communautés et des écosystèmes et des sciences de la conservation qui nécessitent en fin de compte de faire intervenir des questions sociétales complexes. Les différences dans les cultures, les langues, les valeurs et les disciplines des chercheurs qui y sont engagés peuvent parfois aggraver les débats, sur fond d’incompréhensions, de malentendus, et alors quitter la sphère des critiques constructives : passer du scepticisme constitutif de la science à un rejet régulier de faits et de concepts soutenus par un consensus scientifique, voire même au rejet de l’existence d’un tel consensus, ceci pour diverses raisons, dont certaines idéologiques.
Ce déni ou dénialisme s’est particulièrement illustré dans les débats sur le changement climatique mais s’exerce de plus en plus dans de très nombreux domaines des connaissances scientifiques.
Dans le domaine des invasions biologiques et de leur gestion, il s’est assez largement développé depuis au moins deux décennies : la présente confrontation des deux récentes publications nous semble en être un exemple flagrant. En effet, dans son article, Sagoff a, à plusieurs reprises, semblé confondre des éléments de connaissances bien distincts, a utilisé des termes comme “croyance” en les appliquant à des hypothèses conceptuelles partagées par de nombreux chercheurs et a remis en cause les capacités des chercheurs à identifier les répartitions originelles des EEE, en présentant des certitudes ne laissant pas de place au doute.
Dès lors que de telles publications porteuses de déni sont reprises dans des médias plus soucieux d’accroissement d’audience que de véracité scientifique, en sortant ainsi du monde scientifique elles peuvent devenir de puissants instruments de désinformation auprès des politiques, des décideurs et du grand public. Dans une période où ces invasions se poursuivent fortement, voire se multiplient grâce au changement climatique, elles peuvent donc, même indirectement, causer des dommages très importants aux programmes de gestion des EEE, à toutes les échelles, depuis la planète jusqu’aux échelons locaux.
Dans le contexte actuel, l’appel aux éditeurs de revues clairement inscrit en fin de l’article de Cuthbert et al. (2020) à “reconsidérer l’acceptation d’essais négationnistes” n’est sans doute pas une demande isolée.
Une telle remarque faisait déjà partie des réactions de divers spécialistes des invasions biologiques à la suite d’une publication en 2015 de chercheurs anglais concluant à l’absence d’impacts significatifs, en matière de biodiversité, des plantes invasives sur la flore britannique indigène (Thomas et Palmer, 2015). Cette publication et les réactions qu’elle a suscitées ont déjà fait l’objet d’un article sur le site du Centre de ressources “Beaucoup de bruit pour rien ou un mauvais coup à la gestion des EEE ?” (Dutartre, 2015), pour présenter ces risques de désinformation.
S’il reste toujours difficile de “déminer” de telles publications, il semble indispensable de maintenir une vigilance permanente sur ce sujet et que des efforts soient poursuivis pour en dénoncer les risques, en particulier en améliorant nos connaissances et en les partageant de manière de plus en plus efficace.
N.B. : L’adaptation de ces deux articles pour en tirer des éléments utiles aux réflexions sur les enjeux de gestion des EEE que nous cherchons à développer au Centre de Ressources s’est avérée assez complexe. Arriver à une rédaction compréhensible pour le lecteur en conservant autant que possible une même attitude critique des deux textes était un espoir.
Rédaction : Alain Dutartre
Relectures : Franck Courchamp, Biodiversity Dynamics & Macroecology (CNRS), Madeleine Freudenreich (Comité français de l’UICN), Emmanuelle Sarat (Comité français de l’UICN)
Références :
- Sagoff M. 2020. Fact and value in invasion biology. Conservation Biology 34:581–588.
- Cuthbert R.N. et al. 2020. Invasion costs, impacts, and human agency: response to Sagoff 2020. Conserv Biol. 34 (6): 1579-1582
- Pimentel D, Lach L, Zuniga R, Morrison D. 2000. Environmental and economic costs of nonindigenous species in the United States. Bio- Science 50:53–66.
- Pimentel D, Zuniga R, Morrison D. 2005. Update on the environmental and economic costs associated with alien-invasive species in the United States. Ecological Economics 52:273–288.