Bonjour, qui êtes-vous et dans quelle région agissez-vous ?
Quentin Vatrinet : Je travaille pour le Département de Seine-et-Marne (77), où je suis chargé de mission Actions préventives et aménagement durable. C’est à dire qu’à partir du moment où il y a un phénomène ou un mécanisme qui impacte l’eau et les milieux aquatiques, je peux être susceptible d’intervenir pour du conseil, de l’accompagnement de projet et de construction/animation des politiques territoriales dans divers domaines, dont notamment la gestion des EEE.

Mélanie Cheyssou : Je travaille à la mairie de Combs-la-Ville (77), qui est une commune de 22 000 habitants. Je suis cheffe de service développement durable, avec des missions très générales, en lien avec la transition écologique et son déploiement sur le territoire.
Quelles sont vos principales missions et objectifs ?
MC : A peu près 80 % de mes missions sont dédiées à la biodiversité, avec des actions de connaissances, des actions de restauration, de gestion et de sensibilisation avec le grand public de la formation pour les élus et les gestionnaires. Nous réalisons également un suivi des espèces envahissantes sur la commune, notamment pour les chenilles processionnaires et le Frelon asiatique. Pour la flore, nous avons quelques actions concernant les renouées asiatiques, avec des enjeux de continuité écologique.
QV : Au niveau des espèces exotiques envahissantes, le Département anime un groupe de travail sur les espèces envahissantes et impactantes (GT EEI). J’ai la charge du pilotage, accompagné de 2 animateurs. Le GT EEI a pour vocation à construire une stratégie pour faciliter la gestion de ces espèces. L’idée, c’est de mettre en commun toutes les énergies, les connaissances et même les financements, pour pouvoir apporter des réponses transposables d’un territoire à l’autre.
Pouvez-vous présenter en quelques mots votre groupe de travail et sa structuration ?
QV : Le réseau a été construit en plusieurs phases. Un premier groupe de travail animé par la préfecture a existé pendant plusieurs années : il était centré sur les espèces à enjeu sanitaires (frelons asiatiques, chenilles processionnaires…) et chacun y présentait les actions qui étaient mises en place. C’est notamment là que j’ai rencontré Mélanie, et découvert les actions de sa commune. Parallèlement, le nombre de demande d’actions coordonnées de la part des syndicats de rivière, vis-à-vis d’espèces impactant les milieux naturels, a progressivement augmenté. Le Département animait déjà différents groupes de travail via une politique volontariste appelé le Plan Départemental de l’Eau (depuis 2007). Nous avons donc créé le groupe de travail EEI en 2019, pour réunir les différents organismes concernés.
Quand j’ai récupéré le pilotage du groupe de travail et que le sujet de l’ambroisie est arrivé sur la table, c’est là que le groupe a pris de l’ampleur. L’ambroisie n’est pas très présente dans le département, mais la Seine-et-Marne étant un grenier à blé, et du fait du risque sanitaire, les élus se sont tout de suite emparés du sujet.
Le groupe se réunit 4 fois par an, à peu près. Avec chaque fois, l’idée est de reprendre ce qui avait été discuté lors des précédentes réunions et de travailler ensemble dessus. Pour les sujets plus spécifiques, nous pouvons être amené à faire des réunions parallèles en groupe restreint, car travailler à 20 ou 30 sur un document, ce n’est pas toujours évident.
Qui sont vos partenaires ? Avec quels organismes travaillez-vous le plus souvent ?
QV : Le GT EEI est surtout à destination des maîtres d’ouvrage, avec soit des collectivités territoriales, soit des syndicats de rivière, qui vont donc avoir des compétences GEMAPI.
Nous pouvons distinguer trois types de partenaires au sein du groupe de travail. En plus des « maitres d’ouvrages Gemapiens et collectivités » (ex. Syndicat de rivière, porteur de SAGE, Ile de France Nature, etc.), nous avons des « experts », comme la FREDON, l’Agence régionale de Santé, le Conservatoire botaniques national du Bassin parisien (CBN BP) ou l’Institut Paris région ; et également des « organismes publics financeurs de de conseils », avec la DDT, la Région ou l’Agence de l’eau.
Mélanie intervient dans le groupe en tant que collectivité, même si nous apprécions aussi son expertise sur le Frelon et la renouée.
Êtes-vous en relation avec d’autres coordinations régionales ?
MC : Lorsque nous avons débuté les actions sur le frelon et les chenilles, avant la création du GT EEI, nous nous étions déjà rapprochés du groupe de défense sanitaire apicoles (GDSA) et des apiculteurs locaux.
QV : Nous sommes en relation avec le groupe régionale « espèces à enjeux sanitaires pour la santé humaine » et le Plan Régional Santé Environnement 3 (portés par la FREDON et l’ARS). Et depuis l’année dernière, je suis avec intérêt les échanges du REST EEE à l’échelle nationale.
Quand nous on a parlé de ce projet de groupe de travail départemental, il y a des acteurs régionaux qui nous ont dit qu’ils étaient intéressés à rejoindre le projet, en vue de peut-être un jour construire de quelque chose de régional. Mais aujourd’hui, ils n’ont pas forcément le temps dédié pour animer un groupe de travail, et je ne pense pas que le sujet soit identifié comme prioritaire.
Comment décririez-vous votre réseau en un mot ?
QV : C’est un réseau « Collaboratif », chaque membre apporte son expertise soit sur des espèces soit sur des outils de gestion (cartographie, expérimentation de terrains, formation…).
MC : C’est une pluralité d’acteurs. Il y a toutes les échelles dans le GT, ce qui permet une transversalité dans la manière de travailler, mais aussi d’avoir une approche globale (naturaliste, gestionnaire, financeur). Et en plus de ça, la dynamique réseau nous facilite aussi l’approche sur des sujets autres que les EEE, car elle favorise les échanges.
Le réseau nous permet de mieux comprendre les problématiques de chacun, et permet d’avoir une vision plus transversale de sujets et une approche collective de réflexion qui va au-delà de nos problématiques quotidiennes de gestionnaires.
Vos actions concerne-t-elle uniquement la faune ou la flore, ou bien les deux ?
QV : Comme cela a pu être illustré par Mélanie, les actions peuvent concerner à la fois la faune et la flore. Il s’agit principalement d’espèces présentant des enjeux sanitaires, même si j’ai conscience que c’est sur les émergentes que nous pourrions avoir un réel impact en termes de gestion, mais comme les gens ne connaissent pas forcément ces espèces, nous ne sommes pas sollicités sur ces sujets.
L’approche sanitaire est celle qui nous permet de créer de l’intérêt, débuter un dialogue. C’est une porte d’entrée pour ensuite de poursuivre les échanges, en abordant le Myriophylle aquatique (Myriophyllum aquaticum), l’Ailante (Ailanthus altissima) ou la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera).
En parlant d’espèce, avez-vous des listes départementales/régionales et qui les réalise ?
QV : Comme nous ne pouvions pas être sur tous les fronts, très vite, nous avons souhaité faire une liste. Nous nous sommes basés sur un système de pondération de critères, que nous avions trouvé dans un rapport québécois (Pomerleau, 2017) et que nous avons ensuite amélioré avec Mélanie et les autres membres du GT EEI. Le CBN BP était aussi dans les échanges, comme caution scientifique. Ce sont eux qui ont eu le dernier mot. C’est ainsi que nous avons abouti à une première liste de 35 à 40 espèces, mais pour éviter de trop se disperser, il a fallu descendre cette liste à 18 espèces prioritaires, dont 3 émergentes identifiées avec le CBN BP. Ce n’est pas une liste fixe, et nous nous laissons l’opportunité d’enlever ou de rajouter une à deux espèces par an.
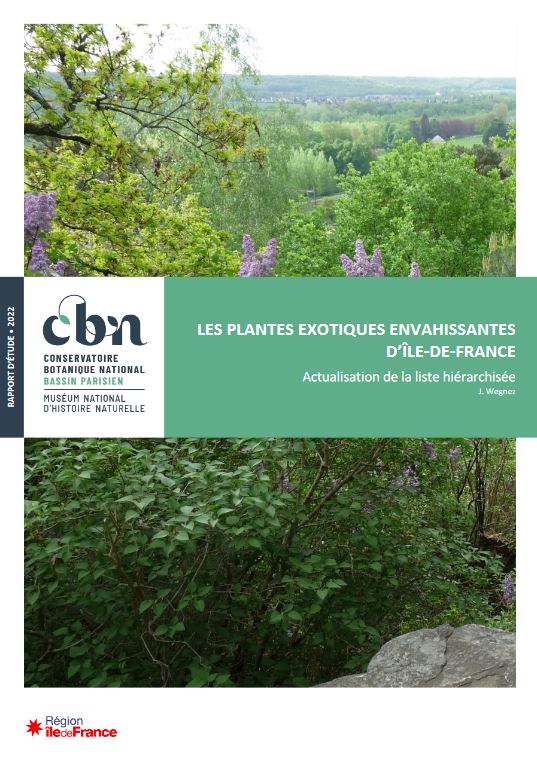 A l’échelle régionale, il y a la Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Ile-de-France (actualisée en 2022) réalisée par le conservatoire botanique national. C’est celle que nous utilisons dans les Plans locaux d’urbanisme (PLU) par exemple, pour identifier les espèces végétales à ne pas planter. Pour la faune, je ne crois pas qu’une liste similaire existe. La fédération de pêche, qui fait partie du GT EEI, possède sa propre liste avec les écrevisses et les poissons exotiques envahissants.
A l’échelle régionale, il y a la Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Ile-de-France (actualisée en 2022) réalisée par le conservatoire botanique national. C’est celle que nous utilisons dans les Plans locaux d’urbanisme (PLU) par exemple, pour identifier les espèces végétales à ne pas planter. Pour la faune, je ne crois pas qu’une liste similaire existe. La fédération de pêche, qui fait partie du GT EEI, possède sa propre liste avec les écrevisses et les poissons exotiques envahissants.
Quelles sont les EEE sur lesquelles vous êtes actuellement les plus sollicités ?
QV : Nous sommes très sollicités sur le Frelon asiatique (Vespa velutina) et la Renouée du Japon car ce sont les espèces les plus répandues et les plus connues.
MC : De notre côté, nous sommes souvent contactés par les communes pour témoigner sur la gestion de nos espaces verts. Il y a un mois, je suis intervenue par exemple avec FREDON Essonne, qui a également un groupe de travail, pour témoigner de ce qu’une commune peut mettre en place comme mesures.
Au niveau local, nous intervenons sur la question des EEI pour des raisons de mise en sécurité des habitants (Frelon asiatique notamment). Notre approche très pratique n’est donc pas seulement liée à la question de la biodiversité mais relève souvent du vivre ensemble.

Si vous aviez la possibilité de faire disparaître de votre région une population d’EEE, laquelle serait-ce et pourquoi ?
MC : Il a dix ans je me disais que la présence de certaines espèces était une calamité, mais maintenant je suis plus modérée. Alors, en effet, il ne faut pas que la renouée s’étende, mais elle joue aussi un rôle phyto-épurateur sur les habitats qu’elle colonise. Et chez nous, elle est présente sur des terrains qui ont été extrêmement pollués par le passé… Les déséquilibres constatés nous conduisent fortement à remettre en question les pratiques humaines (mouvements de terre, exportations d’espèces, destruction des milieux, etc.).
QV : Mon choix aussi, il n’est pas lié à l’espèce en elle-même mais plutôt à ces effets indirects. Pour moi, c’est l’effet de panique que le Frelon asiatique créé chez les gens. Il s’agit du comportement humain autour de cette espèce, souvent irrationnel, qui amène les personnes à paniquer dès qu’ils voient une espèce qui ressemble à un Frelon asiatique. Alors ils vont utiliser tout type de produits chimiques pour en venir à bout, avec des répercutions plus négatives qu’autre chose.
Sinon, en tant qu’ancien technicien, j’aurai peut-être choisi les ambroisies et la Crassule de Helms (Crassula helmsii) qui ne sont pas encore très implantées dans le département, mais qui pourraient avoir des impacts sur notre patrimoine agricole et naturel.
Existe-t-il une stratégie régionale, et comment êtes-vous impliquée dans celle-ci ?
QV : Il n’y a pas à ma connaissance de stratégie régionale dédiée. Pour autant, les EEE sont mentionnées dans les programmes de planification régionaux.
Au sein de notre GT, nous avons un plan d’action structuré en 6 grands projets : Repérage ; Gestion et Lutte ; Expérimentation ; Coordination ; Connaissance ; Financement. Et à chaque fois, au sein de ces projets, une liste d’actions a été identifiée lors de réunions du groupe de travail, en laissant parler l’intelligence collective. Il s’agit du fil conducteur du groupe de travail, où nous indiquons tout ce qui peut être fait.
Il faut encore que nous structurions cette liste, notamment pour affiner les délais parce que on se rend compte que tout le monde fait un petit peu, intervient sur chaque action, mais que nous n’avions pas vraiment définit de date limite pour un résultat. Nous nous sommes alors basés sur la Stratégie régionale EEE Faune du CEN Occitanie, pour réaliser un tableau avec des actions et des délais.
Sur quel(s) projet(s) travaillez-vous actuellement (ou avez-vous travaillé récemment) ?
QV : Avec le groupe de travail, nous nous sommes répartis la rédaction des fiches, que nous aimerions faire charter, afin de les envoyer aux communes qui sont intéressées par le sujet, et qu’elles puissent les utiliser et les transmettre à leurs services techniques et éventuellement aux habitants.
En plus des éléments d’identification, nous indiquons dans les grandes lignes ce qui est possible de faire et ce qu’il ne faut surtout pas faire pour éviter dispersion. Comme nous ne savons pas quelles vont être les compétences techniques de la personne qui va récupérer le document, il ne s’agit pas de recommandations de gestion mais d’éviter au moins qu’elle ne fasse pas n’importe quoi.
Et puis avec Mélanie, nous travaillons sur l’élaboration de recommandations à mettre dans les PLU, les PLUi et pour les CCTP travaux. L’UPGE a déjà fourni un bon modèle de cahier des charges (Union professionnelle du génie écologique, 2020). L’idée ici, c’est de prendre ce qui ce qu’ils ont fait et de prendre ce qui a été fait par les différents maîtres d’ouvrage de Seine-et-Marne ; et de pour chaque rubrique d’un cahier des charges travaux, donner des recommandations pour assurer une bonne gestion des espèces exotiques.
MC : Nous sommes en pleine révision du PLU et nous travaillons sur une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Trame Verte et Bleue (TVB) qui intègrera des enjeux EEI, de désimperméabilisation et de renforcement des continuités écologiques.
Nous avons eu la chance de réaliser entre 2015 et 2019 un Atlas de la biodiversité communale (ABC). Actuellement nous poursuivons les inventaires, notamment sur les milieux humides et menons des actions de restauration de milieux .
Rencontrez-vous des difficultés ou des contraintes sur certaines thématiques ?
MC : Dans sur les espaces boisés, nous retrouvons beaucoup d’espèces exotiques envahissantes, comme le Laurier palme et le Buddleia, qui sont arrivées via des dépôts sauvages. Nous savons aussi que ces espèces problématiques sont encore commercialisées. La règlementation et la communication ne sont actuellement pas suffisantes.
La difficulté est de sensibiliser les habitants, les entreprises et les gestionnaires d’espaces aux dérèglements que peuvent conduire des mauvaises pratiques.
QV : La question financière pour nous, elle n’est pas simple. Parce que comme nous ne sommes pas un réseau régional, nous n’avons pas toujours facilité à aller solliciter les financeurs.
Pour finir, quel est l’aspect de votre travail que vous appréciez le plus ?
QV : C’est la diversité des profils et des expertises. Celle qui fait que l’on part d’un besoin, qui peut être énoncé par n’importe lequel des membres, puis que chacun amène son élément et finalement parfois entre l’idée que je me faisais au départ et la solution mise en avant, et bien j’ai appris ! J’apprends beaucoup de choses en fait, à chaque session et je pense que cet aspect d’enrichissement personnel, qui nourrit et ma curiosité, ma soif d’apprendre, c’est peut-être ce que je préfère le plus.
MC : C’est vraiment l’approche transversale. Cette vision d’ensemble qui nous permet d’avancer en nous sortant de nos petites problématiques locales ou techniques, qui peuvent cloisonner notre vision. Et ça nous apporte finalement une vraie dimension d’ensemble sur le traitement du sujet.

Lien et ressources à partager :
- Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Île-de-France (Wegnez, 2022)
 Rencontres techniques départementales « Gestion des Espèces Envahissantes » – 22 novembre 2021 | Eau en Seine-et-Marne :
Rencontres techniques départementales « Gestion des Espèces Envahissantes » – 22 novembre 2021 | Eau en Seine-et-Marne :
- Présentation des avancées du Groupe de Travail Départemental sur les EEI par Lucile LETERTRE et Quentin VATRINET, (Département 77) ;
- Présentation des caractéristiques et de l’implantation des espèces envahissantes végétales en Seine-et-Marne par Laurent AZUELOS (CBNBP) ;
- Présentation des différents impacts des espèces envahissantes animales et aquatiques en Seine-et-Marne par Maxime LE SIMPLE (Fédération de pêche de Seine-et-Marne) ;
- Retour d’expérience de la commune de Combs-la-Ville abordant l’ensemble des leviers pouvant être activés pour limiter la présence des Espèces Envahissantes (Frelon asiatique et Chenilles processionnaires, notamment), par Mélanie CHEYSSOU (Combs-la-Ville).
Rédaction : Cet entretien a été mené le 15 février, en présence de Madeleine Freudenreich (Comité français de l’UICN), Quentin Vatrinet (Département Seine-et-Marne) et Mélanie Cheyssou (Combs-la-Ville).
