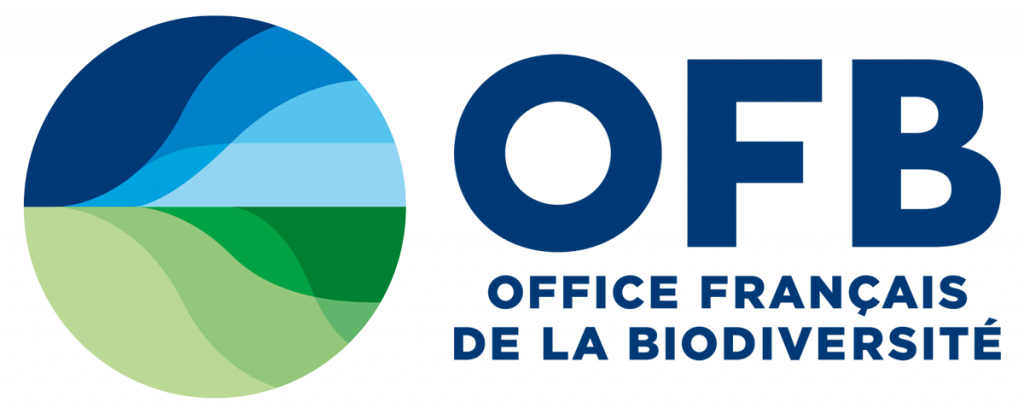Le contrôle biologique ?

En agriculture, la lutte biologique est une méthode de lutte contre un ravageur ou une plante adventice au moyen d’organismes naturels antagonistes de ceux-ci, tels que des phytophages (dans le cas des plantes), des parasitoïdes, des prédateurs ou des agents pathogènes (virus, bactéries, champignons…).
Après des développements importants dans le domaine de l’agriculture, cette technique d’élimination ou de régulation d’adversaires des activités humaines s’est étendue aux espèces exotiques envahissantes colonisant les milieux naturels.
Ainsi, plus généralement, le contrôle biologique peut être considéré comme l’utilisation “d’un organisme vivant comme agent régulateur d’une espèce jugée nuisible” (Beisel, Lévèque, 2010) .
Les dommages écologiques et économiques causés par la prolifération d’espèces exotiques envahissantes commencent à être mieux évalués, tout comme les coûts des interventions de gestion mises en œuvre pour y remédier. Les méthodes de contrôle utilisées classiquement (gestion mécanique, utilisation de produits phytosanitaires, etc.) sont coûteuses, parfois complexes à mettre en œuvre, pas toujours efficaces et peuvent avoir des impacts non souhaités sur l’environnement.
Dans un contexte d’optimisation des coûts de gestion et d’amélioration des résultats, la question du contrôle biologique revient souvent dans les débats. La méthode semble séduisante : économique, facile à mettre en œuvre, applicable à large échelle et sans dommages pour l’environnement. Mais où en sommes-nous sur ce sujet ? Quelles leçons pouvons-nous tirer des expériences passées et quelles sont les améliorations qui ont été apportées depuis ?
Ce dossier présente un bref tour d’horizon sur le contrôle biologique pour alimenter la réflexion sur cette méthode de gestion, ses avantages et ses limites.
Une histoire déjà ancienne : l’exemple sud-africain De nombreux travaux sur les milieux aquatiques Quel potentiel en Europe ? Des avantages et des limites Contrôler le moyen de contrôle
Une histoire déjà ancienne : l’exemple sud-africain
Le 26 Juin 1906, la quatrième commission parlementaire sur la coopération agricole s’est réunie au Cap pour discuter de l’invasion du figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica) dans deux des états d’Afrique du Sud. Cette espèce originaire d’Amérique centrale, présente en Afrique du Sud depuis au moins les années 1750, avait déjà envahi plus de 300 000 ha dans les années 1890.

Selon l’article de Moran et al. (2013) , le docteur Maasdorp, médecin et membre de l’Assemblée législative de la province du Cap, y est intervenu en indiquant qu’il pensait nécessaire d’étudier les conditions de développement de cette espèce dans les pays où elle était indigène, de vérifier si elle y était envahissante, si des ennemis naturels la contrôlaient dans ces pays, s’il n’était pas possible de d’introduire cet ennemi naturel depuis ces pays et que toutes les plantes importées non confrontées à leurs ennemis naturels devenaient des pestes. (“…I think we should find out what are the conditions in those countries in which is indigenous whether it is in the nature of a pest there or not…it may possibly be that in those countries this plant has some natural enemy for keeping within bounds. …and whether it would not be possible to transport that natural enemy to this country. It is a difficulty I think with all imported plants…that where they do not meet their natural enemies they…become a pest.”).
Dans leur article, ces auteurs passent en revue toutes les interventions mises en œuvre en matière de contrôle biologique en Afrique du Sud, région du monde abritant un très grand nombre de plantes exotiques dont au moins une centaine d’espèces d’arbres. Depuis 1913, des entomologistes et des phytopathologistes ont ainsi examiné 270 taxons (espèces ou biotypes) dont 84 % d’insectes, 2 % d’acariens et 11 % d’agents pathogènes pouvant présenter une efficacité dans le domaine. Parmi eux, 106 ont été testés et libérés et 75 se sont établis comme agents de lutte biologique sur 48 espèces de plantes exotiques envahissantes.
L’historique de Moran et al. indique que jusque dans les années 50 les travaux ont portés sur quatre espèces de figuiers de Barbarie (Opuntia sp.)puis ils sont ensuite été élargis au lantana (Lantana camara) à la fin des années 50, à différentes espèces d’arbres depuis le début des années 70. Pour ce qui concerne les plantes aquatiques, la jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes) a fait l’objet de premiers travaux à la fin des années 70, suivie par salvinia (Salvinia molesta) et la laitue d’eau (Pistia stratiotes) à la fin des années 80 et, plus récemment, par le myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) et azolla (Azolla filliculoides).
Depuis la fin des années 1960, cet état a monté des projets de recherche indépendants tout en coopérant étroitement avec d’autres pays de premier plan dans la lutte biologique, comme l’Australie, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Ces échanges permanents lui ont permis de fournir à l’Australie et la Nouvelle-Zélande des agents efficaces de contrôle biologique.
Parmi d’autres informations, dont un résumé des phases successives et des processus impliqués dans la lutte biologique contre les plantes invasives et les défis associés, les auteurs signalent qu’il a fallu attendre 1933, soit, selon eux, un quart de siècle de tergiversations politiques (“a quarter of a century of political prevarication“), pour que l’autorisation d’introduction du papillon de cactus, Cactoblastis cactorum, comme moyen de contrôle du figuier de Barbarie soit accordée. L’explication de cet important délai semble liée aux faits suivants : cette plante produit des fruits comestibles et une variété sans épines avait été longtemps cultivée comme plante fourragère résistant à la sécheresse.
De nombreux travaux sur les milieux aquatiques
Par exemple, dans sa revue sur le contrôle biologique des nuisances aquatiques, Schuytema (1977) a consulté plus de 500 références et passé en revue tous les organismes pouvant être utilisés. Il a également intégré les possibilités dites de “biomanipulation” utilisant des modifications des conditions environnementales des espèces, comme la privation ou la réduction de lumière, les teneurs en nutriments des eaux, etc., ou les relations interspécifiques, comme des sélections d’espèces de poissons pour le contrôle du phytoplancton ou encore des introductions de plantes créant une compétition avec les plantes invasives…
Dans son rapport il rappelle que nombre des recherches référencées correspondent à des travaux en laboratoire et que peu de cas bien documentés sont disponibles sur des projets de lutte à grande échelle (“relatively few well documented instances of large-scale control projects“).

Son analyse montre qu’à l’époque le pâturage et la prédation étaient les techniques les plus fréquemment utilisées, particulièrement pour le contrôle des macrophytes par les poissons. Nombres de ces phytophages et prédateurs ne sont pas spécifiques de l’espèce à contrôler et présentent donc des risques potentiels pour les organismes non visés de l’écosystème, d’où une grande prudence nécessaire dans leur utilisation. Les insectes spécifiques peuvent être beaucoup plus efficaces. Selon cette synthèse, les agents pathogènes étaient déjà considérés comme des organismes de contrôle potentiellement efficaces, mais n’avaient pas encore été utilisés dans des projets de lutte à grande échelle. De même, la biomanipulation était considérée par beaucoup comme un ensemble prometteur de techniques de gestion.
Sa revue porte de manière notable sur les plantes aquatiques, dont la jacinthe d’eau (Eicchornia crassipes). Pour cette espèce il cite par exemple des coléoptères du genre Neochetina en cours d’évaluation, jugés prometteurs (“promising control“) à l’époque. Ces coléoptères ont été très largement utilisés depuis (espèce Neochetina eichhorniae) et Beisel et Lévèque (2010) indiquent que parmi la centaine d’espèces d’insectes testés sur la jacinthe d’eau, une douzaine “s’est révélé capable de provoquer d’importants dommages foliaires” et que des charançons sont utilisés aux USA, en Afrique et en Chine.
Schuytema cite également une rouille (Uredo eicchorniae), alors en cours d’étude en Argentine sur la même plante. Depuis cette époque, au moins une demi-douzaine d’espèces de champignons a fait l’objet d’évaluation et au moins une, Cercospora rodmanii, a été testée apparemment avec succès sur la jacinthe d’eau.
Quel potentiel en Europe ?
A l’échelle mondiale, depuis une centaine d’années, plus de 7 000 introductions d’environ 2 700 agents de contrôle biologique ont été réalisées, principalement en Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Amérique du Nord (Pratt et al., 2013). Pourtant, en Europe continentale, un seul agent de lutte biologique a été introduit pour le contrôle d’une plante exotique envahissante : il s’agit du psylle Aphalara itadori, relâché en Grande-Bretagne en 2010 pour le contrôle de la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) (Shaw et al., 2011).
Dans le passé, plusieurs exemples malheureux de contrôle biologique ont sans doute marqué les esprits de chacun et sont peut-être à
l’origine d’une réticence des pays européens à se lancer dans le contrôle biologique des espèces invasives. Le contrôle biologique est pourtant plus développé à l’Outre-mer, notamment à la Réunion (lutte biologique contre la vigne marronne, Rubus alecifolius) et en Polynésie française (lutte contre le Miconia), où les résultats sont pour l’instant positifs.
L’Europe s’intéresse néanmoins petit à petit au sujet, dans une optique d’amélioration des coûts et des méthodes de gestion employées pour les plantes invasives, mais sans doute un peu contrainte par la Directive cadre sur l’eau, qui exige d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’ici 2015 et qui implique de gérer les EEE à large échelle et avec des méthodes n’employant pas de produits phytocide, de plus en plus interdits d’utilisation dans les milieux aquatiques.
Dans leur revue de 2006 sur le potentiel de contrôle biologique des plantes aquatiques invasives en Europe, André Gassmann et ses collègues du CABI indiquaient que les espèces flottantes et émergentes telles que les jussies (Ludwigia spp), azolla (Azolla filliculoides), la lentille minuscule (Lemna minuta), l’hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides) ou la crassule de Helms (Crassula helmsii) étaient de “bonnes cibles” (“good targets“) pour la lutte biologique classique recourant à l’introduction de coléoptères chrysomélidés et curculionidés spécifiques. Ils indiquaient également que les pathogènes fongiques présentent un certain potentiel contre les espèces flottantes et immergées et que l’utilisation d’agents pathogènes indigènes (mycoherbicides) semblait prometteuse.

La Renouée du Japon a ainsi été ciblée pour développer un programme de contrôle biologique en Grande-Bretagne. Les coûts annuels de gestion de cette espèce, connue pour ses impacts sur la biodiversité et les berges, ont été estimés à 255 millions d’euros au Royaume-Uni. La gestion classique de l’espèce (arrachage mécanique et manuel) est coûteuse et sur le très long terme, pour une efficacité réduite. La possibilité de développer le contrôle biologique a alors été abordée et un programme de recherche a été initié par le CABI et ses partenaires en 2000 (Pratt et al., 2013) .
La première phase du projet a consisté à recenser les ennemis naturels de l’espèce au Japon et d’en sélectionner certains pour des tests sur la renouée dans son aire d’introduction. Les tests ont mis en avant l’efficacité particulière de deux agents, dont le psylle Aphalara itadori, un insecte très spécifique. Trois années de tests ont permis de vérifier la spécificité de consommation du psylle (test sur 90 autres plantes autochtones). Une consultation publique a été réalisée et l’agent de contrôle a été relâché en 2010 après autorisation dans une dizaine de site au Royaume-Uni. L’espèce a résisté à l’hiver, mais le niveau des populations est encore trop faible pour avoir un effet notable. 150 000 individus supplémentaires ont été relâchés en 2013 et aucun impact n’a été recensé sur des végétaux ou invertébrés autochtones. D’autres recherches sont en cours sur l’impact d’un champignon « mycoherbicide », (Mycosphaerella polygoni—uspidati) comme agent de contrôle biologique supplémentaire.
Les résultats de cette première expérience ne sont pas encore disponibles, mais le CABI a tiré plusieurs recommandations pour le bon déroulement d’un programme de contrôle biologique (Shaw et al., 2011):
- Bien choisir la plante cible, en fonction notamment de sa susceptibilité au contrôle biologique, mais en prenant en compte la perception du public, les enjeux économiques et politiques ;
- Utiliser la législation existante sur la santé et la protection des végétaux, notamment pour établir les analyses de risques pour les agents de contrôle biologique et afin d’obtenir des autorisations d’importation, de transport et de de diffusion dans l’environnement en bonne et due forme ;
- Sélectionner une liste de plantes sur lesquelles tester l’agent de contrôle biologique (procédure de sécurité) : cette liste ne doit pas être réduite et doit inclure des espèces d’intérêt économiques et prendre en compte l’opinion publique. Elle doit être validée bien en amont des phases de tests.
- Préparer un plan de suivi avant le relâcher : pour détecter tout impact non prévu sur l’environnement. Ce plan doit être planifié et financé sur une période d’au moins 5 ans, sur plusieurs sites et doit comprendre des mesures de sécurité (insecticides et herbicides à prévoir si des menaces sur les espèces autochtones sont recensées).
- Communiquer largement au préalable avec le public, en délivrant des messages clairs sur les objectifs d’un programme de contrôle biologique, le déroulement de celui-ci et en répondant aux questions fréquemment posées (par exemple, que mangeront les insectes une fois la renouée consommée, qu’en est-il des exemples de contrôle biologique « ratés » (Crapaud buffle en Australie, coccinelle asiatique en Europe), etc.).
Les étapes d’un programme de contrôle biologique1) Initiation du programme de contrôle biologique : choix de la plante invasive cible, analyse des conflits d’intérêts, synthèse bibliographique sur la plante cible et ses ennemis naturels ; 2) Recherches et suivis dans l’aire d’introduction : détermination des associations hôte cible et ennemis naturels, vérification de l’absence d’un agent de contrôle local efficace ; 3) Exploration à l’étranger : en lien avec les structures de recherche implantées dans l’aire d’origine de l’espèce cible, recherche et suivi des ennemis naturels, priorisation des espèces avec un fort potentiel d’agent de contrôle biologique, autorisations réglementaires pour le suivi et l’exportation de ces espèces ; 4) Ecologie de l’espèce cible et de ses ennemis naturels : comparaison de l’écologie de l’espèce dans son aire d’origine et son aire d’introduction, étude des conditions climatiques et écologiques nécessaires au développement de l’agent de contrôle biologique ; 5) Etude sur la spécificité de l’agent de contrôle biologique : évaluation des facteurs physiques, chimiques et nutritionnels en laboratoire et sur le terrain qui vont conditionner la spécificité de consommation de l’agent de contrôle ; études sur toute une gamme d’espèces indigènes (liste de plantes test) ; 6) Relâcher dans l’environnement et suivi : une fois que toutes les études scientifiques ont été réalisées, production d’un dossier soumis aux autorités compétentes, incluant le suivi post-relâcher et l’analyse de risques. |
Des avantages et des limites Avantages
- Mise en œuvre dans toutes les zones cibles (pas de difficultés d’accès aux zones reculées par exemple) ;
- Résultats autosuffisants sur le long terme ;
- Moins de risque pour l’environnement (pas d’utilisation d’herbicides ou de techniques non spécifiques) ;
- Coûts de mise en place du programme moins coûteux à terme que les coûts de gestion régulière classique.
- Durée et coût nécessaires du programme de recherche préalable pour identifier, contrôler et tester les agents potentiels ;
- Temps requis une fois l’agent relâché, pour qu’il se propage et provoque les effets voulus au sein du peuplement ciblé ;
- Incertitude en ce qui concerne le niveau de contrôle du peuplement ciblé induit par l’agent de contrôle;
- Impacts potentiels imprévus de l’agent sur des espèces ou des communautés autochtones non visées ;
- Le mécanisme même de contrôle de la population par contrôle biologique, qui ne permet pas l’éradication mais réduit la densité.
Parmi les questions qu’il reste sans doute utile de se poser sur ces moyens de contrôle des espèces actuellement invasives figurent les évolutions possibles des agents de contrôle eux-mêmes (peuvent-ils évoluer de manière imprévisible ? Devenir sources de nouvelles difficultés par exemple avec les évolutions climatiques à venir ?), voire celles des espèces invasives elles-mêmes (impacts du changement climatique ? Intégration progressive dans les écosystèmes d’accueil ?). Nos connaissances sur le fonctionnement des milieux qui nous environnent sont, hélas, toujours insuffisantes pour espérer intervenir en toute sécurité et les sociétés humaines éprouvent toujours un besoin irrépressible de solutions à court terme : il reste bien difficile d’espérer ne plus jouer à “l’apprenti sorcier” !
“Contrôler le moyen de contrôle” ?
Parmi les réflexions théoriques portant sur les techniques de gestion, une revient assez régulièrement : il s’agit des possibilités de conserver un moyen de “contrôler le moyen de contrôle”, ceci dans le cas où les conséquences de l’intervention ne sont pas celles attendues. Il ne s’agit pas de penser rester systématiquement maître de la gestion mais bien d’envisager ces aléas.
Pour ce qui est des techniques manuelles ou mécaniques, il suffit de mettre ses mains dans ses poches ou de couper le contact de l’engin utilisé pour arrêter l’intervention, ce qui permettrait, par exemple, de positionner une frontière précise de cette intervention.
Il n’en est plus tout à fait de même pour les herbicides dont l’épandage, même en conditions d’absence de courant et de vent dans les milieux aquatique stagnants, présente des zones d’effets pouvant très largement dépasser la superficie visée par le traitement, jusqu’à 1,5 à 2 fois la zone traitée.
Enfin l’utilisation d’agents de contrôle biologique ne peut être confinée et ces organismes peuvent progressivement gagner tout le milieu de leur introduction et tous les autres milieux favorables connectés ou proches. Si l’agent biologique trahit son introducteur en n’agissant pas comme prévu, alors de nouvelles difficultés de gestion tout à fait imprévues peuvent apparaître.
En savoir plus
- Beisel J. N., Lévèque C., 2010. Introduction d’espèces dans les milieux aquatiques. Faut-il avoir peur des invasions biologiques ? Editions QUAE, collection Synthèses, 232 p.
- Moran V.C., Hoffmann J.H., Zimmermann H.G. 2013. 100 years of biological control of invasive alien plants in South Africa: History, practice and achievements. S Afr J Sci. 2013;109(9/10), 1-6
- Schuytema G., S. 1977. Biological control of aquatic nuisances. A review. E. P. A., 600/3- 77-084, 98 p.
- Gassmann A., Cock M. J. W., Shaw R., Evans H. C., 2006. The potential for biological control of invasive alien aquatic weeds in Europe: a review. Hydrobiologia (2006) 570:217–222
- CABI : organisation inter-gouvernementale, sans but lucratif, ayant pour objectif d’améliorer les conditions de vie des populations dans le monde entier en appliquant une expertise scientifique pour résoudre des difficultés en agriculture et en environnement ; une part importante de ses travaux porte sur les possibilités de contrôle biologique des plantes invasives terrestres et aquatiques.
- Shaw, R. H., Tanner, R., Djeddour, D., & Cortat, G. (2011). Classical biological control of Fallopia japonica in the United Kingdom – lessons for Europe. Weed Research, 51(6), 552‑558.
- Site internet du CABI